PAR ANNIE FERRET
Mon père ne prenait presque jamais les petits papiers rose ou verts tendus par les mains des syndicalistes à la sortie de l’usine, parce qu’il ne savait pas lire.
Pourquoi commencer cette chronique par une phrase aussi incongrue qu’autobiographique, étrange et complètement étrangère à une critique littéraire ?
Parce que, quel que soit le lecteur que l’on est, lecteur-écrivain, lecteur impénitent, boulimique, occasionnel, lecteur dilettante, on fermente de tous les livres déjà lus, mais aussi de toutes nos vies vécues, de toutes nos luttes, de toutes nos colères.
Enceinte de mes vies plurielles, de mes luttes, de mes colères, difficile a priori pour moi d’être objective avec un livre pareil, et pourtant, au-delà de ses personnages, du sujet, du combat, c’est la littérature avant tout qu’il faut saluer.
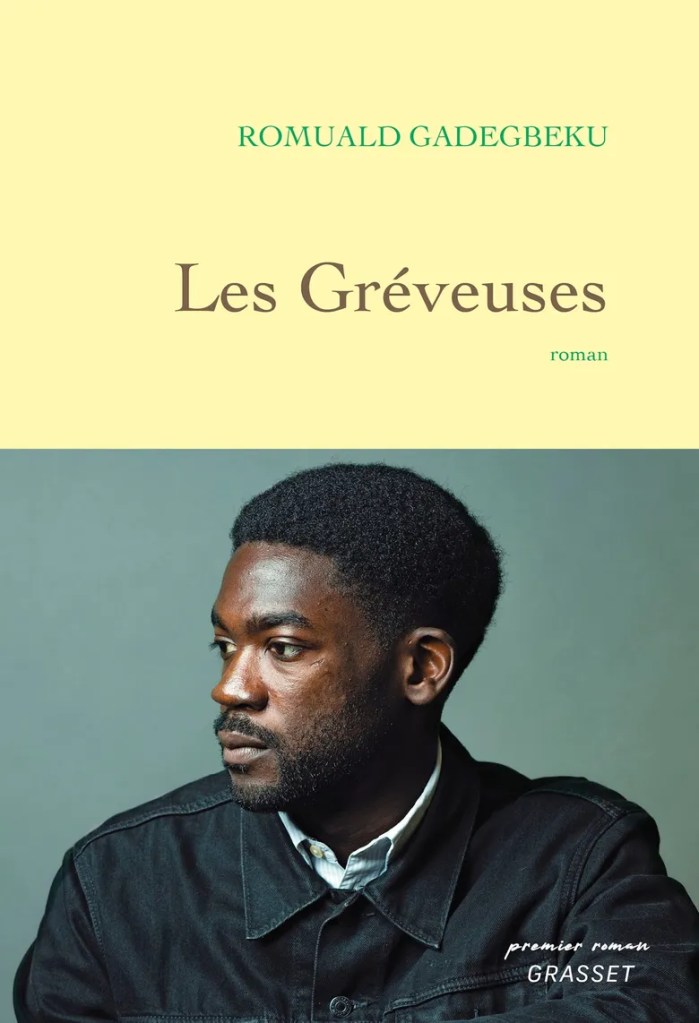
Romuald Gadegbeku entre en écriture avec les Gréveuses, premier roman incroyablement mené de la première à la dernière ligne, qui raconte le destin d’un petit groupe de femmes de chambre – dix-sept – engagées dans une grève illimitée contre la direction de l’hôtel de tourisme où elles travaillent pour défendre leurs droits et obtenir non pas de meilleures conditions de travail, mais, devrait-on dire, des conditions simplement décentes, simplement dignes.
« Premier roman incroyablement mené de la première à la dernière ligne, qui raconte le destin d’un petit groupe de femmes de chambre »
La construction est implacable. Autour de Rita, qui élève seule ses deux garçons, Christian et Loïc, qu’elle parvient à garder à la maison à grand renfort de PlayStation, tant elle a peur de cette cité qui les enferme et rend fou, autour de Mariama, parce que c’est ce qui lui est arrivé qui a déclenché la grève, la goutte de trop, autour de Grande Aminata, de Diva, de toutes les autres, mais aussi des puissants auxquels elles s’opposent, Virginia, la « gouvernante », une qui a grimpé les échelons et campe maintenant dans le parti de l’ennemi, et surtout les patrons qu’on ne rencontre jamais, on voit tournoyer les tours HLM de banlieue, les préoccupations quotidiennes de ces mères de famille, sur qui reposent bien souvent le bien-être et la survie du foyer, et les menaces réelles ou parfois annoncées par les rêves, qui pèsent sur leurs enfants, ces jeunes désœuvrés et qui, parce qu’ils ne semblent avoir de place nulle part, posent çà et là dans la cité des sièges, tabourets, chaises, fauteuils pliants récupérés à droite et à gauche, marques d’un territoire incertain, dans lequel ils s’enracinent dans un ennui sans nom et d’où ils font entendre une langue de leur cru :
Les mecs de RC, que ils parlent, que ils font les fous, ils ont cru leur cité c’était leur daron. La vie, pour une fois c’est pas con cette idée de marketing, ils se font même des T-shirts maintenant, en mode avec gros R et gros C dans le dos, dit Pops. Vas-y, on va s’faire des T-shirts nous aussi, dit Piwi. Vas-y, chaud ! On les mettra dans mon prochain clip, dit Ro. Au fait, qu’est-ce qui t’arrive, Tabouret ? Il commence à s’faire tard, nan, t’es encore là ? sourit Pops. Vas-y toi, arrête de me casser les roubignoles, dit Christian. Les quoi ? demande Piwi. Haha, t’as vu bâtard, tu commences avec tes mots chelous, fait Pops. Quel mot qui va pas ? demande Christian. Fais le malin ! dit Pops.
Baignées elles aussi dans cet idiome, dans les trajets qu’elles effectuent du domicile au parking de l’hôtel, les femmes de ménage changent de monde, mais elles continuent de porter le leur avec elles, partageant des photos, des recettes de cuisine, et presque des souvenirs communs, alors même qu’elles ne parlent pas toutes les mêmes langues, viennent toutes de pays et de religions différents. Tout à coup, on se retrouve à vivre et à scander des slogans avec elles autour du piquet de grève, tant ces femmes sont incarnées et nous tiennent en haleine, chacune avec son parler, sa rudesse et sa générosité. Au fil des pages, elles grandissent aussi, se forment au combat syndical, apprennent à analyser, à remettre en cause leur attitude passée, à faire la différence entre les exploiteurs de tous poils. La victoire qu’on ne peut leur contester est celle de leur solidarité et de leur énergie mise en commun, revivifiée chaque matin, revigorée aussi par les beignets sucrés d’Aminata, le pondu ya madesu de Diva, qui cuisine les feuilles de manioc aux haricots comme personne, et tous les plats qui défilent avec les chants, les danses et les prières. Ces femmes impressionnent par leur ferveur et l’écriture de Romuald Gadegbeku sait rendre magnifiquement ces voix multiples à celles et ceux qu’on appelle communément les sans-voix, les sans-droits aussi, parce que, quelle que soit leur maîtrise de la langue et des codes des exploiteurs, on les tient toujours à l’écart, pour les écraser ou même pour les aider, on les tient « comme un tout, comme un rien », on parle à leur place. C’est là peut-être que l’auteur signe un roman d’une grande subtilité, dans cette dénonciation pleine de nuances, qui n’efface pas les désaccords et les contradictions de chacune, les raisons légitimes que l’on a de se battre pour des droits élémentaires et même celles, tout aussi légitimes, que l’on a de renoncer à le faire :
– Vous vous prenez pour qui pour parler aux gens comme ça ? dit la femme lunettée. Dites-moi où c’est chez elles ?
– En Afrique. Regardez-moi comment elles beuglent.
– Non, c’est ici chez elles, monsieur.
– Je les connais bien les gens comme vous, hein, toujours derrière les grandes causes. Vous croyez que cette bonne femme est votre amie ? Eh ben non, du tout, vous n’êtes que la charrette de ses beaux idéaux, des symboles, vous n’êtes pas son égale, pas même des femmes, et elle le sait.
– Vous dites n’importe quoi espèce de raciste.
– C’est ça, soulage bien ta belle conscience, rombière.
La caisse tremblante en main, Diva veut intervenir. Mais ses bras sont encore étreints par les doigts d’Aminata et Rita. Elle écoute ces deux vieux Blancs bavasser sur leur cas comme si elles n’étaient pas là. Qu’on coupe le son, et leurs grands gestes deviendront ceux de parents se disputant au milieu de leurs enfants. Elle essaie encore de bouger, mais ses copines l’enlacent trop bien. Enfin un silence, Diva s’y infiltre :
– Donc nous on doit oublier nos droits, c’est ça ?
Le vieil homme plisse les yeux. Il ne sait pas laquelle de ces femmes noires vient de parler, alors il répond en les regardant vaguement, comme un tout, comme un rien.
– Ça a toujours été comme ça, oui, mon grand-père, un Polonais, il a charbonné dans les mines du Nord, mon papi, et il n’a jamais rien demandé à personne, dernier arrivé, dernier servi, c’est comme ça que ça a toujours marché.
Les gréveuses se figent, se regardent les unes les autres, avec dans les yeux un doute partagé, celui d’une règle tacite qu’elles connaissaient, et qui leur avait fait continuer à courber l’échine sans se plaindre. Diva a encore de la salive plein la bouche, écume blanche et rageuse aux commissures des lèvres. Elle est d’accord, à 200 % même, avec ce que vient de dire ce type, et ça lui donne encore plus envie de lui balancer sa grosse urne dans la gueule.
Sa vilaine tête lui rappelle pourquoi elle a hésité à commencer sa lutte. Elle pensait que le travail la mènerait dans un meilleur ailleurs. Elle le pense toujours. C’est ce qu’on lui a répété. Elle se voyait bien bosser comme gouvernante au contact de la clientèle, des employés des bureaux, ou peut-être se remettre à fond dans la coiffure, et ouvrir un salon un jour. L’ambition éloigne des autres, et même au milieu d’elles, cette ambition reste intacte. Vouloir mieux l’avait déjà éloignée des siens, et fait venir dans ce pays, elle connaît ça.
Écho de plusieurs combats acharnés de ces dernières années, les Gréveuses a cette force de caisse de résonance qui colle au quotidien.
Encore faut-il avoir une oreille pour les « petits », ceux dont les combats sont perdus d’avance, parce qu’ils ne sont tout simplement pas à armes égales. On est sans doute plusieurs à avoir en tête l’emblématique grève des femmes de ménage de l’Ibis Batignolles entamée en 2019 : 22 mois de bagarre. Elles ont gagné, certes, mais pas tant que ça.
Sauf, notre respect, qui se doit d’être immense.
Mais qui se souvient aussi de celles de l’Holiday Inn de Clichy : 111 jours en 2018 ?
De celles de Sciences Po en mars de cette année ?
Du Radisson Blu à Marseille ?
Du Campanile de Suresnes ?
Du personnel de propreté du service des Impôts ?

Les Gréveuses ne fait pas que s’emparer d’un fait de société, il donne vie à ces femmes, en leur offrant une chair et plusieurs langues, de ces combats perdus, il fait un livre où triomphe la littérature dans ce qu’elle a de plus enveloppant : nous faire pénétrer, si près de nous, dans un « meilleur ailleurs », même si personne n’est dupe, loin de la Grève des bàttu d’Aminata Sow Fall, qu’on ne peut pas manquer non plus d’évoquer à la lecture de Romuald Gadegbeku, la fable politique, laissée inachevée comme la marque d’une lutte jamais finie, donne ici plutôt envie de paraphraser Patrick Chamoiseau, parce qu’en effet, que peuvent les petits et les faibles, quand ils ne peuvent ?
Annie Ferret, le 30 octobre 2025,
(extraits cités p. 228 et 87-89 , extrait lu p. 115-117)