PAR ANNIE FERRET
Par un chemin peut-être inattendu, trois ans après son deuxième roman, le Feu du milieu, Touhfat Mouhtare signe avec Choses qui arrivent un récit bref, autofictionnel, maîtrisé, tressé et complexe comme une fable. Elle y revient, dans une chronologie volontairement floue et erratique, sur un épisode de sa vie particulier, celui où la fille de diplomate qu’elle était a « volontairement » perdu ses papiers et son droit de séjour en France, se retrouvant à la case départ et partageant alors le sort de milliers de sans-papiers. Quatre années au cours desquelles, nécessité faisant loi, la ville lui a enseigné une autre géographie, d’autres habitudes, d’autres réflexes, une existence où elle s’est dédoublée, a grandi, a cherché, d’abord en vain, puis trouvé, vers qui, vers quoi, vers où tendre, quel récit écrire, parce que ce chapitre de sa vie, authentique, certes, constitue surtout, pour la romancière en devenir qu’elle est à cette époque, un prétexte à interroger le monde, une sorte de curieuse mise à l’épreuve se substituant pour ainsi dire à l’initiation brutale à laquelle elle avait échappé jusque là.
Jusque là, en effet, en dépit de quelques effets de manche, on sent bien comme tout était facile, l’obtention du baccalauréat, une simple formalité pour la lycéenne brillante, l’apposition du visa, sésame ouvrant à son passeport les portes du territoire français, une évidence pour la famille d’où elle est issue ; petite dernière, née d’un père déjà âgé, elle a néanmoins grandi comme si depuis toujours le monde était sur le point de la quitter, dans l’urgence, sur le qui-vive, tenaillée par l’attente du pire, et comme pour mettre en conformité ses jours avec cette impression de vivre dans un dangereux équilibre au-dessus du vide, elle a créé de toutes pièces cette suspension, cette peur terrifiante et vivifiante à la fois, prendre le risque que les choses arrivent, bonnes ou mauvaises, tout plutôt que l’insatisfaction d’un chemin tout tracé et depuis longtemps par les autres. Et c’est bien ainsi qu’elle le raconte, parce que Choses qui arrivent n’est pas un simple récit, mais l’analyse d’un parcours, « auto-enquête », pourrait-on dire, autocritique aussi :
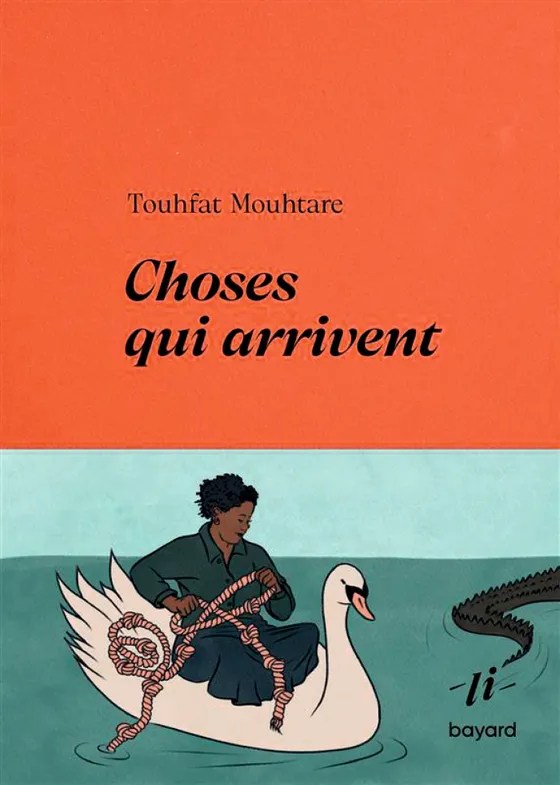
Il existe une façon de ne pas trahir la promesse de ne pas trop vivre, ou du moins s’en donner l’illusion, lorsque les conséquences s’avèrent, à raison, vertigineuses.
Elle consiste à ne jamais quitter le giron de la validation parentale. Celle-ci peut pallier, dans bien des cas, les creux laissés dans le lien d’amour, le trop-plein de conditions à ce dernier. Alors on s’intéresse aux autres et on rejoint enfin la vague que l’on a longtemps fuie ; on comprend qu’on n’y a pas échappé, on a cru l’éviter ; par conséquent on ne la rejoint pas, on prend seulement conscience que l’on en a toujours fait partie, et il faut alors tourner le dos au leurre dans lequel on a pataugé durant tant d’années, pour faire face enfin aux autres qui jamais n’ont été dupes de ce jeu puisqu’ils y jouent, y ont joué, n’y jouent plus mais y retourneront à nouveau : les semblables.
Ceux qui partent, toutes attaches déliées, se donnent en effet une chance, voulue ou subie, de renouveler l’humus du lien familial, de se débarrasser des écailles de la fille parfaite ou du fils prodige pour laisser la place à l’inconditionnel. (p.112-113)
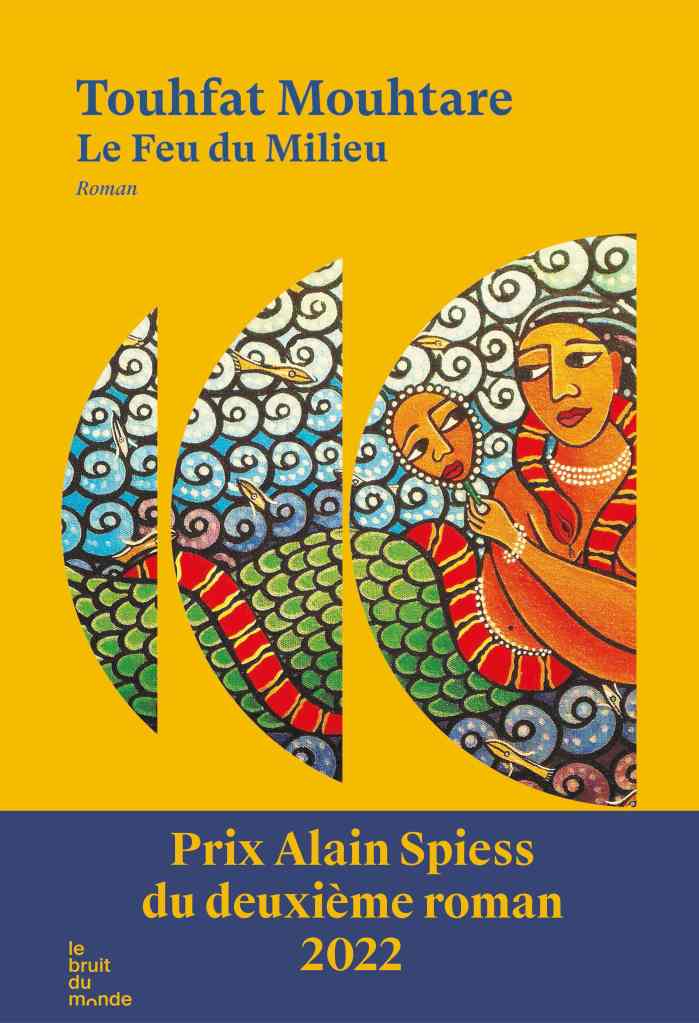
Dans le Feu du milieu, le personnage de Gaillard devait résoudre cinq énigmes. C’était là autant un chemin d’apprentissage spirituel que les étapes d’une initiation aux épreuves terrestres, mais le roman, par la mise à distance de la fiction, formait une sorte d’écran protecteur, cette fois encore, forte de cette expérience, de même qu’elle n’oublie jamais l’enseignement de la philosophie soufie, reçu en premier lieu de son père, quand l’émotion devient trop intime, Touhfat Mouhtare sait user de cette même fiction, la tissant de réel de temps à autre, la mettant en avant telle un bouclier, quand elle le souhaite, ainsi de la « corde nouée », métaphore et architecture du texte lui-même, qui emprunte opportunément la voix d’un humble :
On raconte, ô sultan des mers et des terres, on raconte que dans la ville de Mekka vivait un berger bédouin qui s’était fait messager du divin. (p.171)
Alors, quand le récit se déploie en onze boucles dénouées, dans une langue belle et subtile, où l’on ne sait plus ce qui domine de la poésie ou de l’esprit, il faut comprendre que c’est cette voix, ce personnage qui l’imposent, et nullement la narratrice, qui a disparu :
Pour chaque vers déclamé, il dénouait un des nœuds. Les deux poèmes-prières comportaient respectivement six et cinq vers ; onze au total, comme les onze boucles de la corde. (p.173)
Manière de rappeler, comme tout romancier le sait déjà, comme le lecteur le sait sans doute également, que, quel que soit le pouvoir de l’écriture, ces choses qui arrivent dans la vie, toujours, dépassent la fiction.
Annie Ferret, le 16 août 2025,
Touhfat Mouhtare, Choses qui arrivent, Bayard, 2025
extrait lu p.10-12