PAR DAROUÈCHE HILALI BACAR
« This is a man’s world
This is a man’s world
But it would be nothing
Nothing without a woman or a girl… »
James Brown
« Écrire au féminin » est le premier concours littéraire organisé par la direction du livre et de la lecture publique (DLLP) du Conseil départemental en partenariat avec la délégation régionale des droits aux femmes de la Préfecture de Mayotte pour soutenir et encourager la création littéraire, en particulier la création littérature féminine. Deux catégories ont été primées. Dans la catégorie « Roman Adulte », le prix a été décerné à Abdoul Fouadi1 pour son texte à caractère militant et politique, « La cause », et dans la catégorie « Roman Jeunesse », le prix est donné à Nadia Boina pour son texte fantastique « Fandzava et le monde des esprits ».
En attendant de lire les textes des deux lauréat-e-s, il nous est permis ici de nous interroger sur l’émergence de la littérature féminine à Mayotte. Et dans les limites de cet article, de réserver notre analyse aux textes de trois auteurs afin de mieux les faire comprendre et de mettre en évidence ce qui les caractérise.
- Bref aperçu de la condition féminine dans la littérature mahoraise
La condition des femmes à Mayotte a toujours été l’affaire des écrivains hommes, connus ou moins connus comme par exemple Naouirou Issoufali qui dénonce dans Femmes d’ici et d’ailleurs (éd. 2011) les « Violences conjugales » (p.25), l’infamie dans « Polygamie » (p.29) et qui sensibilise le lecteur sur les traitements infligés aux « Femme[s] » (p.24) dans une société qui vante son système matrilinéaire et glorifie le rôle qu’ont joué les Chatouilleuses dans l’histoire de Mayotte. Nassuf Djailani qui, dans la nouvelle « Auprès d’elle » tirée de L’irrésistible nécessité de mordre dans une mangue (éd. 2014, p.28-37), nous fait partager l’angoisse de sa narratrice qui doit assumer seule sa grossesse et dans un autre récit, « Transie semence » extrait d’Une saison aux Comores (éd. 2005, p.65-69) dénonce le viol. Ou encore Alain Kamal Martial dans Papa m’a suicideR (éd. 2006) qui, sous prétexte de raconter la nuit des noces de son héroïne Marie, fait éclater la vérité de l’inceste commis par le père. L’inceste est aussi le thème central de la pièce de théâtre d’Ambass Ridjali, Scandales dans la famille X (éd. 2007), un thème également repris par Nassur Attoumani dans son roman au titre provocateur Tonton ! rends-moi ma virginité (éd. 2015). Ailleurs, dans Les Veuves (éd. 2008), Alain Kamal Martial se fait encore défenseur des droits des femmes en évoquant, sous la forme d’une allégorie, les droits matrimoniaux à la mort annoncée de l’époux polygame.
- Éclats de voix féminines dans la littérature mahoraise
Il nous semble que l’année 2006 marque l’entrée des femmes écrivaines dans la littérature mahoraise d’expression française. Elles prennent la plume pour affirmer leur présence, pour s’affranchir des contraintes socioculturelles et religieuses, de la domination des hommes dans leur rôle de walî pl. awliyâ’, c’est-à-dire « responsables légaux » et, par extension, « porte-paroles » et « défenseurs » (de leurs droits) dans la société et dans l’espace littéraire. Elles veulent être leur propre « porte-parole » pour défendre leur cause chacune à sa manière, avec ses propres mots, son propre style, certes parfois mal assuré mais assumé. Elles se racontent et livrent une histoire singulière, dénoncent les conditions de vie des femmes mahoraises et expriment leurs aspirations légitimes.
Laoura Ahmed dans Le contenu de la fiole (éd. 2006) choisit le « conte » pour relater les aventures, les espérances, les rêveries et les romances de la jeunesse mahoraise. Zahara Silahi s’essaie au « théâtre » avec La rumeur (éd. 2016) pour mettre en scène le commérage des femmes qui meuble le quotidien. Abby Saïd Adinani expérimente avec talent la « nouvelle » dans un texte intitulé C’est la faute au portable (éd. 2018) pour raconter l’histoire de la jeune « Salima » qui rêve de s’extraire de son milieu social pour vivre une vie faite d’aventures et de voyages. Zayna K. écrit son « récit autobiographique », Une vie effacée (éd. 2020), centré sur la maladie qui lui a fait quitter l’île de Mayotte pour aller, avec sa famille, se soigner en métropole.
Quant à nos trois auteures, Rihana Hamidouna, Rozette Yssouf et Fatima Baco, elles s’engagent sur la même voie que la célèbre journaliste Séline Soula avec Zawou la Mahoraise (éd., 2008) en racontant leurs histoires par le truchement d’un personnage de fiction, donnant ainsi à lire des autobiographies fictives sous la forme de romans et de recueil de poésie.
- Trois auteures représentatives de la littérature féminine
- Rihana Hamidouna et la thérapie du couple

Dans Loufoque ou insoumise ? Paris ouverts pour cette fille seule face à une société phallocrate (éd. 2013), Rihana Hamidouna s’essaie à l’écriture du moi à caractère psychanalytique. L’auteure a recours à la distanciation par le biais d’un personnage de fiction et d’une narration à la troisième personne du singulier, un procédé qui permet de mieux se raconter. Nous suivons l’histoire de Zenya, une jeune fille de douze ans, élevée selon les traditions mais très avertie de la question de l’émancipation féminine : « Proche d’une rebelle quand on discutait de certains sujets telle la relation homme et femme, elle savait défendre ses idéologies » (p.6). Comme toute jeune fille de son âge, elle rêve d’amour, de prince charmant. Elle souhaite vivre une histoire de contes de fée, les récits des Mille et une nuit, tout du moins ces passions qui font vibrer les téléspectateurs mahorais captivés par les romances indiennes (Disco dancer, 1982), les séries américaines (Amour, Gloire et Beauté, 1987) ou encore les novelas hispaniques (Marimar, 1994). Un style de vie qui déplait à sa grand-mère. Et les deux personnages, les deux générations en débattent et s’opposent :
– Depuis que ces maudites boîtes dans lesquelles défilent des gens sont là, vous commencez à vous habiller comme eux ; ce n’est pas bon tout ça : vous dévoilez à tout le monde ce qui est à préserver pour votre futur époux.
–La télé! cette boîte s’appelle une télévision Mamie ! et, les filles qu’on voit dedans ne se marient pas vierge, elles n’attendent pas le mariage pour passer à l’acte sexuel…, on risque de vouloir faire comme elles plus tard.
[…]
–Oui, c’est dommage. Bientôt tout le monde couchera avec tout le monde, vous allez faire de l’amour gloire et beautéś ! … Mon dieu, avec les jeunes d’aujourd’hui, on court à la catastrophe ! le malheur va s’abattre sur nous bientôt. » (p.8-9)
Mais Zenya sait ce qu’elle veut, la vie qu’elle souhaite avoir, le genre d’homme avec qui elle souhaite vivre :
« Mamie […] je voudrais que ce soit un homme qui me choisisse et non pas sa mère ; et je voudrais qu’il m’aime pour ce que je suis et qu’il m’accepte telle quelle. S’il me sait fainéante et qu’il n’aime pas les fainéantes, vaut mieux pas qu’il me choisisse, c’est tout simple. Et, on en revient à cette idée que je ne risque pas d’être mariée un jour, mais je préfère ça qu’être changée en ce que je ne suis pas. Mais Mamie, ça, tu ne peux pas comprendre, la famille, son honneur c’est que ça qui t’intéresse, et ma propre personne alors ? Je ne risque pas de trouver mon bonheur dans un contexte comme celui-là je te promets, je me sentirais trop emprisonnée pour être heureuse. » (p.12)
Impatiente de lui trouver un prétendant pour la marier selon la coutume, la famille lui présente un jeune homme de bonne famille, Danir. Il paraît sérieux, patient, fidèle, attentionné, ouvert d’esprit. Il dit comprendre qu’il est légitime pour la femme mahoraise de prendre la place qui lui est due dans le monde du travail. Il encourage donc Zenya à aller au bout de ses ambitions, à faire des études, de longues études, avant de parler mariage. « Je suis l’un de ceux qui pensent qu’il faut prendre le temps de se connaître avant de se marier », affirme-t-il. (p.11) Après avoir obtenu le Bac, elle quitte l’île pour la métropole pour faire ses études de médecine. À son retour, à 22 ans, elle épouse Danir son amour d’enfance. Mais quelle déception !
« Toutefois, les blâmes et les humiliations continuaient, pendant que tout le monde autour d’eux attendait l’annonce d’une éventuelle grossesse… Le temps passa sans qu’une grossesse ne fut annoncée, ni sans que les blâmes ne cessèrent. Les critiques (sur les tâches ménagères…) devenaient un supplice. Elle ne comprenait pas les reproches de Danir alors qu’elle faisait son travail domestique de façon impeccable » (p.15).
Zenya comprendra plus tard les véritables raisons de ces reproches incessants. Après trois ans de mariage, son mari décide de prendre une seconde femme pour avoir un enfant et se rassurer sur sa virilité. Il se justifie lâchement en se retranchant derrière la tradition et la religion : « Je suis un homme, il faut suivre l’exemple du prophète non, ce n’est pas le Coran qui dit ‘‘épousez jusqu’à quatre femmes’’ ? » (p.22) Cette déclaration plonge Zenya dans la dépression, dans un état d’effondrement psychique duquel elle t’entera de sortir non sans difficulté.
Ce bouleversement psychique s’accompagne d’un changement de narration qui passe de la troisième à la première personne. Le « je » permet à l’auteure de s’exprimer davantage et de réduire la distanciation pour se rapprocher de son personnage principal. Elle s’interroge, s’examine, doute et, comme l’écrivaine égyptienne May al-Tilmîsânî dans Dunyâzâd (Douniazad, traduit chez Actes Sud, 2000), doute aussi de sa féminité :
« Qu’est-ce que je deviens dans tout cela ?! L’épouse cocue, marâtre d’un bel enfant illégitime ? Celle qui a été incapable de lui en faire un, la nulle à chier ! Pourquoi il m’a fait ça, pourquoi m’a-t-il trompé ? On n’a pas encore tout essayé et il abandonne déjà ?! Suis-je gâtée à ce point-là ? Suis-je nulle au point de ne plus arriver à satisfaire ses besoins ? Ou bien qu’est-ce qui se passe, ne lui suffis-je pas ? » (p.33)
Que devrait-elle faire ? Quitter son mari ? N’est-ce pas elle qui a idéalisé le couple et a encouragé les autres femmes de maris polygames ou infidèles à les quitter si elles sont malheureuses ?
« […] il n’est pas trop tard, tu es encore jeune et belle, tu peux encore reprendre le dessus, exiger de lui qu’il t’offre une belle vie, ou le quitter si cela est impossible pour t’offrir tes chances avec un autre homme » (p.17)
Les questions s’enchaînent révélant le profond mal être de la narratrice. Le texte digresse alors et s’engage dans une réflexion philosophique et un processus psychanalytique à propos de la déception amoureuse. Comme pour une étude de cas, ici, « Comment surmonter un chagrin d’amour ? », la narratrice se fait passer par les différentes étapes du problème posé, à savoir : pleurer, se confier à une tierce personne, reconnaître ses véritables amis, libérer sa colère, trouver du réconfort auprès des proches ou d’amis bienveillants, réfléchir aux décisions à prendre, reprendre le contrôle de ses émotions et chasser les idées négatives. Le programme déconseille les reproches, la mauvaise estime de soi et la vengeance. Il est conseillé de dialoguer, de se débarrasser des idées suicidaires, de transcender la douleur à l’aide de différents moyens et thérapies traditionnelles et religieuses (p.35-46).
Ici l’auteure se présente sous les traits du psychologue qui utilise l’écriture fictionnelle à des fins thérapeutiques. On peut donc penser que cet ouvrage est à lire comme un exemple de « thérapie de couple » qui décrit étape par étape le processus d’une auto-guérison et d’une reconstruction de soi au sortir d’une déception amoureuse.
Enfin guérie, la narratrice décide de pardonner à son mari. Et ils eurent plusieurs enfants ensemble :
« Il y a des choses plus douloureuses que votre cœur n’oubliera pas facilement, des choses bien réelles mais qui ont l’aire stupide, avant de les juger, posez-vous la question « qu’est-ce que j’aurais fait à sa place mais ayez confiance, le temps fera son effet. Le cœur a des capacités de guérison hallucinante. Comme dans un état de deuil, la vie continue pour ceux qui vivent.
Puis, le temps passera, vous en parlerez encore, vous aurez toujours l’occasion d’en parler, et enfin de compte le rire disparaîtra pour laisser place au dégoût. Quand vous repenserai à toute l’histoire, vous ne souffrirez plus, mais vous ne rirez plus non plus, vous aurez juste envie de vomir : comment des gens sont capables de faire de telles choses! Pitoyable !
Enfin, un jour vous rirez du fait que les pires choses qui pouvaient vous séparer n’y sont pas arrivées. Vous vous direz, inchallah, y a que la mort qui nous séparera (dans un futur bien lointain). » (p.46)
Est-ce une forme de résilience ? Est-ce grâce à la religion et à ses préceptes que la narratrice réussit à surmonter sa détresse et son désarroi ? Pour Rozette Yssouf, la sublimation, ou le dépassement de soi, nous aide à panser nos blessures et à nous réconcilier avec nous-mêmes.
- Rozette Yssouf et le combat d’une vie

Docteure en psychologie de l’Université de Strasbourg et psychologue clinicienne à l’EPSM du Morbihan, Rozette Yssouf porte une attention particulière aux souffrances des femmes victimes de violences conjugales, familiales et sociétales. S’inspirant de la sublimation de soi, concept qu’elle théorise dans sa thèse doctorale, elle raconte dans ses récits, ses romans, ses poèmes le mal être des femmes qui transcendent leurs souffrances psychiques pour continuer à vivre. Pour l’auteure, l’écriture littéraire permet non seulement de s’examiner mais aussi de se libérer des contraintes socioculturelles et religieuses. © Rozette Yssouf
La solitude du cœur, franchir les obstacles de la vie et devenir soi (éd. 2015) s’inscrit dans la même veine littéraire et Rozette Yssouf signe là le texte sans doute le plus abouti de l’écriture du moi. Avec l’emploi exclusif de la première personne du singulier, l’auteure retrace son enfance à Mayotte, son adolescence à La Réunion et sa vie d’étudiante en métropole. Une lecture attentive montre que le strict cadre autobiographique, selon Philippe Lejeune2, s’agrandit avec l’approche psychanalytique et permet à l’auteure d’explorer le paysage intérieur, de sonder l’intime par le truchement de personnages de fiction, « Sarah » (p.64, p.127), « Bella » (p.89), « Zaza »(p.109). La distanciation entre l’auteure et la narratrice s’opère également à un autre niveau, lorsque la narratrice fait appel à « Angélina », correspondante imaginaire de son journal intime : « chère Angélina, je ne t’ai pas oubliée, comment le pourrais-je ? Tu es la seule qui me comprenne. » (p.21)

L’innocence de l’enfance et son monde féerique disparaissent à mesure que les crises culturelles et identitaires, nées de la confrontation entre la réalité sociale réunionnaise3 et métropolitaine4, entraînent la narratrice dans un processus d’introspection de ses aspirations, de ses rencontres, de ses aventures sentimentales et de déceptions qui sont la cause de sa souffrance psychique. Elle qui croyait tant aux contes de fée et au prince charmant, concède, dépitée : « Les Hommes m’ont énormément déçue » (p.63).
Étudiante à Montpellier, elle fait d’abord la rencontre de « Gotcha », un jeune homme au physique peu avantageux mais beau parleur, séducteur et, comme disent les Égyptiens, niswandjî, « homme à femmes ». Elle a quand même voulu « lui donner une chance de [la] surprendre dans le bon sens » (p.64). Mais il la trompe avec son ex-copine avec laquelle il choisira de rester. Elle fait ensuite la rencontre de « Yahaya », un garçon d’apparence timide et blessé par un chagrin d’amour. Il ne souhaite pas s’engager dans une nouvelle relation sérieuse mais ne voit pas d’inconvénient à flirter et à assouvir ses désirs (p.87-96). Vient le tour du « Beau Gosse » qui sait jouer de son physique avantageux pour charmer les filles, les faire languir et les manipuler (p.107-126).
Lors de son examen de conscience, la narratrice ne s’épargne aucune critique. Elle reconnaît avoir fait du tort à certains hommes sans doute bien intentionnés, sincères, comme « James » par exemple, resté auprès d’elle dans les moments difficiles (p.128-130), « Chou », le malheureux qu’elle a éconduit (p.130-131), « Miaou » qui s’est senti trahi après deux longues années de relation virtuelle sans issue (p.131-132). Elle se justifie en invoquant la blessure causée par trop de déceptions amoureuses : « Je suis coupable, certainement [mais], je ne pouvais plus aimer. J’étais vidée de tout l’amour qui me restait dans mon pauvre cœur meurtri. » (p.133)
La blessure est si profonde que la narratrice perd goût à la vie. Elle cesse de se nourrir, de dormir, de sortir. Elle s’enferme dans le noir. Elle présente tous les symptômes d’un profond mal-être. Elle tombe en dépression :
« Je sens en moi une terrible sensation de mal être, de désespoir, d’amertume, d’envie de tout foutre en l’air, de disparaître, de sauter, de tomber, bref l’envie plus que jamais de mourir. Je ne sens plus l’amour, l’amitié, la joie, il ne me reste rien, rien au monde qui me donne de l’espoir. Je craque, je stresse, je m’affole, je ne veux plus vivre, ni nourriture, ni eau, ni me couvrir du froid, ni chaleur, ni amour, ni pitié, ni amis, plus rien qui en vaut vraiment la peine. Je m’effondre, [Ils ont] tué mon cœur, il m’a contraint à la solitude éternelle. [Ils ont] enlevé tout le bien qu’il y avait en moi, tout le respect que je me portais, tout ce que j’aimais de ma personnalité. [Ils m’ont] condamnée à mort dans ce monde et je n’ai plus de vie, plus rien qui me reste, je suis bien en vie mais morte à tout jamais car dans mon fort intérieur, je n’existe plus. » (p.86).
Heureusement, sa famille la soutient. Elle l’envoie à Mayotte pour la faire soigner par les thérapies traditionnelles comme le massage à l’huile de coco et autres rites dont seuls les anciens connaissent les secrets. Le séjour est bénéfique. Entourée de la bienveillance de siens et de la communauté, la narratrice s’est ressourcée : « Je me sentais enfin en paix ! » (p.153). Elle décide de retourner en métropole pour poursuivre des études en psychologie puis en sciences de l’éducation.
Quelques années plus tard, le questionnement existentiel revient et se fait plus pressent encore. La narratrice apprend qu’elle attend un enfant qu’elle devra élever seule à Mayotte : « Je suis peut-être enceinte […], je suis partagée entre deux sentiments contradictoires à mon sens : l’immense joie de porter une vie en moi et une très grande peur. La peur d’avoir un enfant toute seule sans son père à mes côtés. » (p.167) Ses craintes se confirment lorsque le père, resté en métropole, émet des doutes sur la paternité de l’enfant et demande un test ADN. En réalité, il refuse d’assumer sa responsabilité.
Comment vivre seule la grossesse ? Comment élever seule un enfant ? Comment être une mère célibataire dans une société aussi traditionnaliste et conservatrice que la société mahoraise ? Comment affronter le regard réprobateur des proches, des voisins, des amis, de la communauté ? Avorter ? Fuir, partir loin, quitter l’île ? Ou assumer ?
Des questions sans réponse. Pourtant la narratrice prend la décision de garder l’enfant et d’assumer ses responsabilités de mère mais loin de Mayotte :
« Mon chéri, je ne veux pas t’élever dans cette société qui a perdu tout son côté humain. Ah mon bébé, je t’ai fait dans les mauvaises conditions, ni père, ni stabilité affective. Pourquoi, Dieu t’a fait venir dans cette période si dure pour ta maman ? Je ne veux pas te voir souffrir, comment je pourrais te protéger mon cœur ? Ta maman est égoïste, elle aurait dû réfléchir. Mais tu es là et j’en assume l’entière responsabilité. Tu es mon destin, et tu es là, je t’ai longtemps attendu, espéré mais je n’osais pas te désirer, tu es un bonheur trop intense, trop merveilleux, rien ne pourrait t’égaler dans ce monde, tu es ma vie, mon étoile, ma raison de vivre pour toujours. » (p.174-175)
La narratrice trouve refuge à La Réunion. Elle mène sa grossesse à terme sans angoisses et sans pression sociale. Dans cet environnement serein, la narratrice apprend à devenir mère. Elle parle au bébé à naître. Elle le met en garde contre la dureté de la vie, les conflits parentaux, les conditions de vie des mères célibataires. Avec l’enfant, elle veut nouer un lien fort et solide. Elle veut combler le vide, laissé par ses échecs, de son amour maternel, le seul et véritable amour qui donne sens à la vie, qui donne la force d’exister, comme on le voit dans ce passage :
« C’est aujourd’hui que tu es né mon chéri d’amour. Je suis la femme et la mère la plus comblée du monde entier. Je t’aime à l’infini mon cœur. […] Tu es l’être le plus précieux de ma vie, tu es mon essentiel, toutes mes peines, mes chagrins, mes douleurs se sont envolés […]. Tu m’as fait renaître une seconde fois. Tu m’as redonné [goût à] la vie. » (p.196)
Un évènement tragique va bouleverser la narratrice : le décès de sa mère qui l’a toujours soutenue, aidée, aimée : « ma très chère mère est décédée un certain vendredi 7 mai à 8h30 après avoir passé 5 jours dans le coma à cause d’une tumeur au cerveau découverte tardivement. […] Elle était ma raison de vivre, ma raison d’être, ma joie, mon bonheur, mon tout, je ne pourrais lui rendre tout ce qu’elle a fait pour moi et elle mérite le Paradis éternel. » (p.198)
Doit-elle céder à la dépression, aux idées suicidaires ? Doit-elle vivre envers et contre tout ? Pour surmonter cette douleur, la narratrice puise toute la force dans l’amour pour son fils qui, devinant le fragile équilibre de sa mère, lui demande de ne pas abandonner : « […] je suis là maman, je suis avec toi ma petite maman chérie que j’aime de tout mon cœur, je veux pouvoir […] te procurer tout le bonheur que tu mérites. Non ma chère maman, sois forte et ne te laisse pas abattre. » (p.189) Et à la fin du récit, la narratrice a définitivement tranché. Elle veut vivre et vivre pour son fils :
« Je dois survivre, avancer quoi qu’il arrive. Je dois supporter le mépris des uns, la jalousie infondée des autres et une solitude de cœur indépendante de ma volonté. » (p.294)
Et plus loin, elle ajoute :
« Je ne suis pas un cas désespéré, je suis encore récupérable, il suffit de me donner une chance de croire en moi, il vous suffit de vous donner une chance et d’être convaincu que vous avez votre utilité dans ce monde. Ce qui nous amène à dire, que notre vie a un sens quoi que nous fassions, nous ne sommes jamais sur terre par hasard, on a notre domaine de prédilection, nous sommes faits pour quelqu’un ou pour quelque chose. Pourquoi continuer à discuter, nous avons mieux à faire, accomplir notre légende personnelle ! » (p.301)
Grâce à l’amour maternel, la narratrice renoue avec la pulsion de vie. Elle a sa destinée en main. Elle reprend ses études de psychologie et prépare un master entre La Réunion et Mayotte (p.199). Elle fait le bilan de sa jeunesse dans l’analyse psychanalytique de ses relations amoureuses et amicales (p.201-292) pour tirer les enseignements de sa vie à avenir.
Le texte se termine sur la révélation de secrets de famille, sur des violences sexuelles que l’auteure s’engage à combattre dans ses écrits futurs au nom de toutes les femmes mahoraises : « Tant que je serai en vie, je me battrai, je passerai des messages de prévention pour qu’on puisse arrêter ces personnes qui nous brisent et nous détruisent à jamais. Cessez de nous violer et soignez-nous ! » (p. 304). Un combat que Fatima Baco mène déjà dans son premier recueil de poèmes…
- Fatima Baco et le deuil de l’enfance

Dans Les mots des maux (éd. 2017), Fatima Baco pose les mêmes questions existentielles, et avec une franchise, un accent de sincérité qui se trouvent rarement dans la littérature féminine mahoraise, sans doute ce qui amène Christophe Cosker à la rapprocher de Rimbaud (cf. préface, p.7-9). Comme le dit l’allitération poétique du titre, Fatima Baco cherche à mettre des « mots » sur les « maux » de la société mahoraise à partir de son vécu et de ses expériences individuelles, donnant ainsi l’illusion autobiographique. En effet, les textes prennent une dimension profondément intime, intimiste même, par l’emploi récurrent du « je » lyrique.
« J’ai fait de mes larmes une signature,
De ma souffrance un art.
Je n’essuie plus mes larmes avec un mouchoir.
Je prends appui sur ma plume telle une canne.
Je confie ma peine sereinement à une feuille pâle.
Elle m’écouta, elle ne me jugea point.
J’ai vu en elle une amie, une confidente. » (p.11)
Mais, en réalité, le vécu n’est convoqué ici que pour donner de la matière à la fiction poétique, pour dire des expériences malheureuses ou tragiques vécues par les femmes de manière générale dans le but de dénoncer les violences et les atrocités dont elles sont victimes dans l’île de Mayotte. Une île dont le nom en langue arabe – djazîrat mâyût ou plutôt djazîrat al-mawt, littéralement « île de la mort » en référence aux bateaux des navigateurs arabes qui chaviraient en s’approchant des barrières de corail ou qui faisaient halte sur l’île pour enterrer leurs morts –, rappelle encore aujourd’hui la dangerosité de la traversée de ce bras de mer séparant l’île française des Comores :
« […]
Un vent gris déraisonné, sans contrôle.
D’un coup, la mer s’agite vigoureusement ;
Voilà que les vagues deviennent épaisses,
Un rideau noir emprisonne la mer,
Tout devient flou.
Le soleil a soudainement disparu.
Au loin, laissant seule la mer avec le vent,
Une pluie de roche d’eau jaillit du ciel,
Un ciel grisâtre tel du goudron.
Plus d’harmonie, la mer en colère
Se défend, mais en vain.
[…]
Je n’ose point bouger. Mes membres sont glacés,
La peur tremble aussi. Bientôt elle s’enfuit.
Me laissant la seule certitude d’une mort incertaine » (p.38)
Mais aussi et, bien évidemment, par extension, la dureté de la vie dans l’île, notamment pour les femmes, comme on peut le lire dans plusieurs passages de ce recueil :
« […]
Passèrent les années humides,
Vinrent les longs mois poussiéreux.
Les heures s’alourdissent sous mes yeux sanglants.
Le cri anonyme d’une révolte nuageuse
Ronfla étroitement en moi.
Et pourtant, autant que je m’en souvienne,
Je fus jetée sans bagage dans les ruelles affamées,
Chaude le jour, froide la nuit.
La damnée ! Ils m’appelaient
Libre ! Revendiqué-je. » (p.42-43)
Dénoncer les violences faites aux femmes : les infidélités et les trahisons des hommes envers leurs bien-aimées rêvant d’une vie de princesse ; l’abandon du foyer par le père de famille laissant femme et enfants à la merci de la pauvreté et de la mendicité ; les violences physiques exercées par les hommes sous l’emprise de l’alcool, de la drogue ou tout simplement pris par la folie de la colère ; les violences sexuelles subies par les jeunes mariées au soir de leur nuit de noces :
« Le soir de nos noces,
Tu brûlas mon sexe de tes jouissances animalières,
M’arrachant mon innocence.
Le cœur résigné et dégoûté,
Je m’inclinais amèrement
Et je m’allongeais… » (p.42)
Et aussi dénoncer l’inceste qui détruit à jamais la vie de nombreuses jeunes filles :
« Chaque soir, des pas glaçants chuchotent dans ma chambre.
Je ne dis mot…
Mon œil aigri se fane dans un tourbillon de douleur…
Plus son souffle s’allonge…, plus mon corps se meurt…
[…]
Moi enfant, volée de sa virginité, son innocence tôt dans la vie
Écoutez-moi…
Femme brisée, femme violée, femme morte… » (p.13)
« Je pleure comme un enfant.
Encore et encore,
L’homme à l’œil rouge revient encore dans mes cauchemars
[…]
Ce portrait est celui de mon père.
Pourquoi il souille mon corps de ses baisers criminels ?
Petite enfant innocente qui cherche la tendresse d’un père
Mon sexe est le seul responsable.
C’est lui qui est la proie de cet homme.
‘‘Non’’, dit ma psychologue.
Alors qui ? » (p.17)
« Ma vie garde la blessure du soir de mai à jamais,
Trouvant le fruit de mes entrailles
Allongé sur le carreau froid,
Le sexe sanglant, le corps pâle.
Horreur ! » (p.20)
Des violences morales, psychiques et physiques commises au su et au vu de tout le monde mais qu’aucune femme n’ose dénoncer par peur de déshonorer la famille, de choquer la bonne conscience ou d’ébranler les normes socioreligieuses si bien établies dans la société mahoraise. Par conséquent, se refusant à porter leur histoire devant la justice ou sur la place publique, les victimes n’ont d’autres choix que de sombrer dans la dépression, de céder à l’effondrement psychique. Certaines vont même jusqu’à souhaiter la mort :
« Dormir et ne point me réveiller, tel est mon souhait :
Une descente aux enfers par une journée extraordinaire. » (p.21)
D’autres mettent fin à leurs jours et font de leurs enfants des orphelins, futures « bombes psychiques » à retardement :
« Un beau et triste jour, elle trouva sa mère
Abandonnée de tous ses pères tel un déchet de la nature.
Elle voulut se jeter d’un mont.
Mais, mère avant d’être la fille de l’imâm,
Elle prit son fils dans ses bras généreux
Pleins d’amour inépuisable,
Et le pas allongé,
Elle alla à la recherche de l’eldorado. » (p.16)
En guise de conclusion
Rihana Hamidouna, Rozette Yssouf et Fatima Baco portent un regard très personnel et subjectif sur les conditions de vie des femmes à Mayotte. Leurs textes parlent des violences qui leur sont faites. Violences psychiques qui découlent des déceptions amoureuses, des maltraitances émotionnelles. Violences morales pour les femmes abandonnées qui doivent élever seules leurs enfants et assumer leur statut de « mères célibataires » dans une société traditionnelle et moralisatrice. Violences physiques et sexuelles pour les jeunes filles victimes d’inceste et devant (sur)vivre avec leur traumatisme tout au long de leur vie.
Les auteures se sont inspirées de leur vécu, des faits réels et l’on peut se demander s’il faut voir leurs écrits comme des autobiographies ou comme des fictions ? A première vue, il serait rapide et facile de privilégier la référentialité des textes dont les moralistes n’hésiteraient pas à se saisir afin d’essentialiser les critiques adressées à la société mahoraise et de désavouer des auteures qui osent dévoiler leur intimité et les secrets de famille. Mais une lecture attentive et plus approfondie permet d’en déceler les enjeux littéraires. S’inspirant donc de leur vécu, les trois auteures créent des histoires et des personnages de fiction pour se raconter et s’adresser aussi à la société mahoraise. L’écriture romanesque et poétique fait office de thérapie, de cure thérapeutique qui passe par l’introspection de « soi » dans son environnement social, culturel et familial afin de mettre au jour les causes profondes du mal être, de la souffrance psychique. Elle fait naître un regard critique qui se porte sur soi et sur la société qui l’entoure. Dans les textes présentés ici apparaissent alors et s’affirment les visées incontestablement réformistes qu’ils renferment.
Les ouvrages ont, semble-t-il, bénéficié d’un accueil favorable de la part des lecteurs et notamment le texte de Rozette Yssouf qui a suscité de nombreux débats, parfois virulents, sur les réseaux sociaux5. La critique journalistique lui a également consacré plusieurs articles, qui soulignent les réflexions« sociologiques » et « anthropologiques » qu’elle propose pour s’ouvrir à une connaissance plus juste et à compréhension plus profonde de la société mahoraise6.
Est-il possible d’évaluer l’influence de ces trois expériences littéraires ? Ont-elles aidé à libérer la parole des femmes mahoraises victimes de violences ?
Sur un plan personnel, le texte de Rihana Hamidouna et l’histoire de Zenya auraient encouragé d’autres jeunes femmes à s’engager dans l’écriture : « Son texte fut le tour de son île, et réveilla quelques-unes de ses femmes qui subissaient le comportement machiste de leurs hommes. Il inspira, par exemple, à une certaine ‘‘princesse’’ qui se sentait délaissée, qui répondait au prénom de Nouna. » (p.49) Sur le plan social, il est encore trop tôt pour le dire mais force est de constater quelques avancées significatives. En effet, un nombre croissant de jeunes femmes bravent les interdits sociaux et religieux, parlent d’elles et de leurs souffrances dans l’espace public.
Sur les réseaux sociaux, par exemple, de manière anonyme, les jeunes femmes abordent toutes les questions de société ainsi que les problèmes personnels comme, par exemple, la marque douloureuse laissée par la déception sentimentale. Et récemment sur Mayotte 1ère , la sociologue Maria Mroivili, a témoigné des violences conjugales qu’elle aurait subies7.
Un espace de liberté semble s’ouvrir. Et la littérature féminine a encore de beaux jours devant elle…
Notes bibliographiques
1 Selon les indications du jury, il s’agit d’un « pseudonyme ». Pour autant, on ne peut que s’interroger sur l’acceptation d’un texte portant le nom d’un candidat prétendument masculin alors que ce concours a été exclusivement ouvert aux femmes. Notre interrogation étant davantage légitime lorsqu’on apprend l’identité réelle de ce « Abdoul Fouadi ». Il s’agit en réalité de Yasmina Aouny, figure de proue du mouvement des « femmes leaders », et qui n’est autre que l’épouse du directeur de la DLLP.
2 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, éd. Seuil, Paris, 1975, rééd. 1997.
3 Nouvellement arrivée à La Réunion, la narratrice est confrontée au racisme et à l’exclusion, ce qui va la pousser à s’interroger sur sa « francité », et la reconnaissance de sa culture et de son identité au sein de la nation française. À ce sujet, lire le remarquable essai d’Andinani Said Ali sur la communauté mahoraise à La Réunion : C’est qui mon voisin ? (éd. Jets d’Encre, St-Maur-des-Fossés, 2018).
4 Cf. La question du racisme et de l’exclusion en métropole sera longuement développée par la narratrice dans le chapitre intitulé « Le citoyen dans le sens le plus large » (p.139-156).
5 Voir : https://www.facebook.com/738912602843015/posts/927873857280221/
6 Voir : https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/09/25/ultramarins-de-bretagne-55-de-mamoudzou-carnac-le-chemin-de-la-reconstruction-pour-la-psychologue-rozette-yssouf-289291.html
7 On utilisera ici le conditionnel car l’affaire est portée devant la justice. Voir le témoignage de Maria Mroivili : https://www.facebook.com/watch/?v=638398616802685
*Daroueche Hilali Bacar,
Docteur en études arabes, chercheur en littérature arabophone et francophone de la période moderne et contemporaine – CIRSI Centre international pour les recherches et les études interculturelles en Italie & ICREM Institut de coopération régionale et européenne de Mayotte.





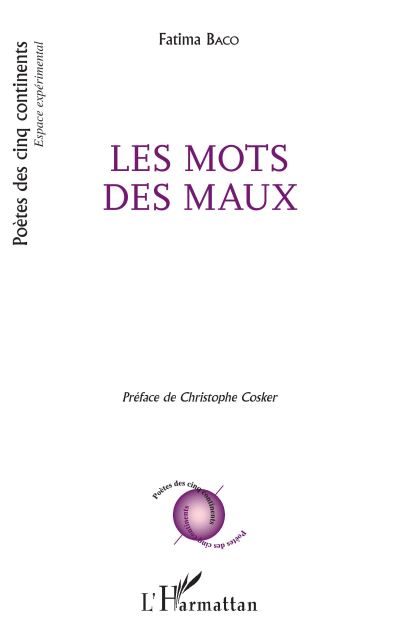

Bravo Mr Darouéche Hilali Bacar pour votre magnifique revue. Très contente de vous lire.